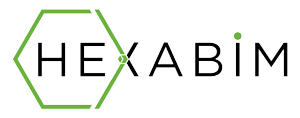Ce que change (et ne change pas) Revit 2026 : décryptage par métiers et enjeux
Chaque année, les nouvelles versions des logiciels BIM font l'objet d'analyses enthousiastes… ou critiques. Sur HEXABIM, ce n'est pas dans nos habitudes d'enchaîner les décryptages de version. Notre ligne reste indépendante et centrée sur les usages, pas sur les outils. Mais cette fois, nous faisons une entorse à la règle.
Pourquoi ? Parce que cette version 2026 de Revit mérite un arrêt sur image : non pas pour ce qu'elle promet, mais pour ce qu'elle révèle. Elle marque une transition technique et symbolique dans l'évolution du logiciel phare d'Autodesk. Entre mise à jour graphique, gestes vers l'openBIM, et petits pas vers plus d'automatisation, cette version soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et elle concerne, directement ou indirectement, une grande partie des professionnels du secteur – qu'ils soient architectes, ingénieurs structure, fluides, coordinateurs, ou formateurs.
Pour cet article, nous avons passé au crible les ressources officielles, testé les retours des premiers utilisateurs, et surtout croisé les points de vue proposés dans plusieurs analyses reconnues : Village BIM (Autodesk France), Archi Communications, BIMsmith, AECbytes (Dan Stine), et d'autres sources spécialisées. L'objectif n'est pas de lister toutes les nouveautés, mais de vous proposer une lecture métier et critique de ce que cette version change – ou pas – dans vos pratiques.
Derrière la longue liste de nouveautés, une trajectoire se dessine : Autodesk continue d'ajuster Revit sans chercher la rupture, mais en renforçant progressivement son socle technique. Plusieurs lignes directrices ressortent clairement dans cette version 2026 :
- la modernisation du moteur graphique, amorcée avec l'option d'affichage accéléré (encore en aperçu technique), qui ouvre la voie à une meilleure exploitation du GPU ;
- la rationalisation des livrables, grâce à des outils de positionnement automatisé des vues, de personnalisation des étiquettes, ou d'amélioration des nomenclatures ;
- la flexibilité accrue dans la modélisation, avec des murs multicouches plus souples, une topographie enrichie, et des paramètres plus ouverts à l'adaptation projet ;
- l'ouverture aux échanges et aux analyses environnementales, visible dans les progrès d'Insight, l'optimisation des imports IFC, ou l'évolution de Data Exchange.
Pas de révolution spectaculaire, mais une consolidation par petites touches : les workflows se fluidifient, les marges d'erreur se réduisent, et l'automatisation s'infiltre là où elle peut faire gagner du temps.
Voici maintenant un tour d'horizon thématique, métier par métier, pour vous aider à repérer ce qui peut changer concrètement dans vos projets.
Architecture : plus de souplesse, plus de cohérence
Les concepteurs gagnent en liberté et en contrôle sur les éléments de construction. Les éléments multicouches (murs, sols, toitures, plafonds, toposolides) peuvent désormais être créés sans couche cœur, avec une priorité de couche personnalisable (indépendante de la fonction), facilitant les jonctions et la gestion graphique.
L'outil de création de murs par pièce ou par segment offre un vrai gain de temps pour les phases de calage ou d'aménagement intérieur. Les murs peuvent suivre automatiquement le périmètre d'une pièce ou être créés à partir de lignes sélectionnées — avec la possibilité d'inclure ou d'exclure les poteaux via la touche Tab.
Côté documentation, la mise à jour du positionnement des vues sur les feuilles permet d'enregistrer des emplacements et de les appliquer à d'autres vues, garantissant une cohérence graphique sur l'ensemble du projet. Un atout majeur pour les équipes qui gèrent des jeux de plans complexes.
Enfin, la version intègre Insight nouvelle génération, avec une interface unifiée pour les zones de système, un suivi du carbone opérationnel et embarqué, et une exportation gbXML plus fidèle. L'analyse environnementale devient plus fluide, plus accessible, et plus structurante dès l'avant-projet.
Structure : une modélisation plus précise et plus fiable
Les ingénieurs structure disposent de nouveaux outils pour modéliser des situations complexes avec davantage de réalisme. C'est le cas du ferraillage en attente baïonnette, désormais paramétrique, ou encore du sens de création des armatures, clairement indiqué en vue 2D et 3D pour anticiper crochets et terminaisons.
Le treillis soudé gagne en précision avec la possibilité de spécifier l'orientation du fil côté enrobage. Quant à la modélisation des éléments en acier, elle devient plus fidèle : les retraits automatiques entre assemblages peuvent être désactivés pour une modélisation point à point, plus exacte et moins sujette aux conflits.
Enfin, les assemblages métalliques personnalisés peuvent désormais être édités de façon plus souple : déplacement des composants, modification de matériaux (notamment pour les platines), et paramétrage de surface de peinture ou de poids exact.
MEP : continuité de conception et meilleure gestion des équipements
Pour les métiers du CVC et de l'électricité, plusieurs améliorations visent à fluidifier les circuits et à mieux représenter les réseaux. La fusion entre zones CVC et zones de système permet une gestion plus logique et homogène, avec des types affectables et des propriétés intégrables dans les nomenclatures.
La gestion des câbles multiconducteurs marque une avancée importante en électricité, avec la possibilité de configurer finement les tailles, types et paramètres depuis une nouvelle interface dédiée. Les méthodes de calcul de la puissance apparente sont également plus transparentes, avec prise en compte du Cos Phi dans les charges analytiques.
La nomenclature des tableaux s'améliore avec plus de champs, une meilleure organisation, et l'inclusion des départs en attente et réserves. L'acheminement des circuits est plus intelligent, notamment dans le cas de familles imbriquées, avec des comportements plus cohérents lors des connexions.
Côté modélisation, les adaptateurs MEP gagnent en précision (géométrie, alignements, décalages) et l'éditeur de contenu inclut un aperçu 3D de la pièce modélisée avec ses connecteurs. Cela facilite la vérification visuelle avant validation.
Topographie et site : un outil enfin mature
Les toposolides, introduits en 2024, franchissent un cap en devenant véritablement exploitables en production. Les subdivisions acceptent désormais des valeurs négatives, permettant de modéliser creux et décaissements. Chaque subdivision peut adopter un type différent, avec matériaux spécifiques.
La copie de points ou lignes devient possible entre toits, dalles et toposolides, simplifiant les manipulations répétitives. Et pour les projets complexes, le nombre de points maximal passe de 10 000 à 50 000 (modifiable dans le fichier Revit.ini), élargissant les possibilités sans pour autant sacrifier la performance.
Les volumes de coupe/remblai sont plus précis, et une option permet d'augmenter la stabilité des opérations booléennes. Du côté des modèles liés, l'import de fichiers Civil 3D bénéficie d'une meilleure fidélité géométrique, un vrai plus pour les workflows BIM infrastructure/architecture.
Documentation : automatisation et personnalisation
Cette version pousse la logique d'automatisation documentaire un cran plus loin. La numérotation basée sur des règles permet d'attribuer automatiquement des identifiants aux éléments (murs, panneaux, armatures…) selon des gabarits définis, avec gestion des doublons, tris par géométrie ou par paramètres, et remplacement des numéros manuellement si besoin.
Les étiquettes de vues de référence (sections, coupes, élévations, repères) peuvent maintenant intégrer des paramètres partagés, rendant leur personnalisation bien plus flexible, avec un affichage cohérent dans les nomenclatures.
La nomenclature des feuilles gagne en clarté avec de nouveaux champs (dimensions, échelle, cartouche principal) et la gestion avancée des collections de feuilles. Un paramètre texte de remplacement d'échelle permet d'éviter le trop générique "comme indiqué" en cas de vues à échelles multiples.
Interfaces et expérience utilisateur : des améliorations ciblées
Par petites touches, l'interface continue son évolution. Des options de modification sont déplacées de la barre d'options vers le ruban, pour une meilleure cohérence visuelle. Le navigateur de projet à onglets fait son apparition, rendant l'organisation plus lisible — avec un affichage contextuel selon les éléments présents dans le projet.
Le correcteur orthographique intégré (enfin !) surligne les fautes dans les zones de texte, avec suggestions à la clé. Un gain de rigueur bienvenue dans les notes de plans.
La gestion des liens s'enrichit aussi : les fichiers CAO importés apparaissent désormais dans la boîte de dialogue « Gérer les liens », et non plus uniquement en passant par la visibilité des vues. Le tri, la recherche, et les filtres sont améliorés, pour mieux superviser les données externes.
Une évolution continue dans l'écosystème Autodesk
Cette version s'inscrit dans une trajectoire déjà amorcée : celle d'un Revit modernisé par étapes, sans rupture. On observe une volonté claire d'aligner progressivement Revit avec le reste de l'écosystème Autodesk, à travers des ponts renforcés vers Insight, Forma, Twinmotion ou encore Data Exchange. Ces intégrations visent une logique de plateforme interconnectée, où Revit n'est plus isolé, mais devient un maillon fluide dans un cycle de conception étendu — de la planification urbaine au suivi carbone.
L'intégration native d'Insight ou la compatibilité renforcée avec Twinmotion ne sont pas anodines : elles traduisent une convergence vers des outils cloud et analytiques, plus adaptés aux pratiques actuelles (et aux business models d'Autodesk). Reste que Revit reste encore une application majoritairement locale, et que la vraie bascule vers le "cloud BIM" est à venir… peut-être avec Forma ?
Revit et l'openBIM : une interopérabilité toujours à parfaire
Côté openBIM, les avancées sont réelles, mais mesurées. Le chargement des fichiers IFC jusqu'à 50 % plus rapide est une bonne nouvelle, tout comme les options de positionnement plus fines à l'import. On sent qu'il y a un effort pour rendre les workflows IFC plus fluides, notamment pour les projets collaboratifs interlogiciels.
Mais l'openBIM dans Revit reste un domaine en tension : si des progrès techniques sont là, l'expérience utilisateur, elle, reste perfectible. Et certaines limitations persistent sur les classifications, les propriétés IFC ou la gestion des structures de fichier complexes. En résumé : Revit devient plus "open-compatible", mais reste fondamentalement pensé pour des workflows Autodesk-first.
Automatisation, IA et gestion des données : une attente forte, un virage encore discret
Les utilisateurs attendent beaucoup des technologies émergentes : automatisation, personnalisation avancée, analyse prédictive, voire IA générative. Revit 2026 montre quelques signes d'ouverture : meilleure gestion des paramètres partagés, numérotation automatique, correcteur orthographique, etc. Mais pour l'instant, ces outils relèvent plus de la productivité assistée que de l'intelligence logicielle.
Côté données, on note quelques avancées intéressantes (classification personnalisable, enrichissement des nomenclatures, meilleure exploitation des paramètres), mais Revit reste encore loin d'une vraie exploitation "data-centric". Les scripts Dynamo évoluent, mais l'accessibilité à l'automatisation reste limitée à des profils avancés.
En clair : les briques sont là, mais la promesse de l'IA ou de la conception automatisée reste à l'horizon — ou dans d'autres produits (Forma, Spacemaker, etc.). Pour l'instant, c'est surtout une standardisation intelligente qui se met en place.
Les utilisateurs face à cette version : entre optimisations utiles et attentes reportées
Dans les retours utilisateurs déjà partagés en ligne, une impression revient : de nombreuses améliorations attendues, mais aucune révolution majeure. Le mode graphique accéléré fait parler de lui, mais reste en préversion. Les nouveautés comme le positionnement des vues, la création de murs par pièce, ou la gestion des armatures sont bien accueillies — car elles répondent à des irritants récurrents du quotidien.
Mais beaucoup regrettent l'absence d'innovation marquante. Certains évoquent une forme d'essoufflement ou de prudence stratégique. D'autres y voient au contraire une maturité assumée, une stabilisation bienvenue. Ce qui est sûr, c'est que cette version consolide des usages existants plutôt qu'elle n'ouvre de nouveaux possibles.
Et maintenant ? Vers une refonte progressive, ou vers autre chose ?
Les indices sont là : moteur graphique en refonte, intégrations cloud, séparation des fonctions (Revit, Forma, Insight), logique modulaire… Il est probable qu'Autodesk prépare une refonte plus structurelle de Revit à moyen terme, ou une transition vers une nouvelle génération d'outils — peut-être plus adaptés aux pratiques agiles, aux usages collaboratifs natifs, et aux nouveaux standards BIM.
Mais en attendant, cette version 2026 continue de servir de socle robuste. Elle n'est pas là pour faire rêver, mais pour faire mieux — et c'est déjà un objectif respectable.
Pour consulter la liste complète et officielle des nouveautés, rendez-vous sur le site Autodesk :
https://help.autodesk.com/view/RVT/2026/FRA/?guid=GUID-C81929D7-02CB-4BF7-A637-9B98EC9EB38B
Les illustrations utilisées dans cet article proviennent du site officiel Autodesk rubrique nouveautés Revit 2026 (lien ci-dessus).